Écouter l'article
Fatigue cognitive, motivationnelle, émotionnelle ou sensorielle : apprenez à les distinguer pour mieux progresser en mémoire sans perdre le rythme.
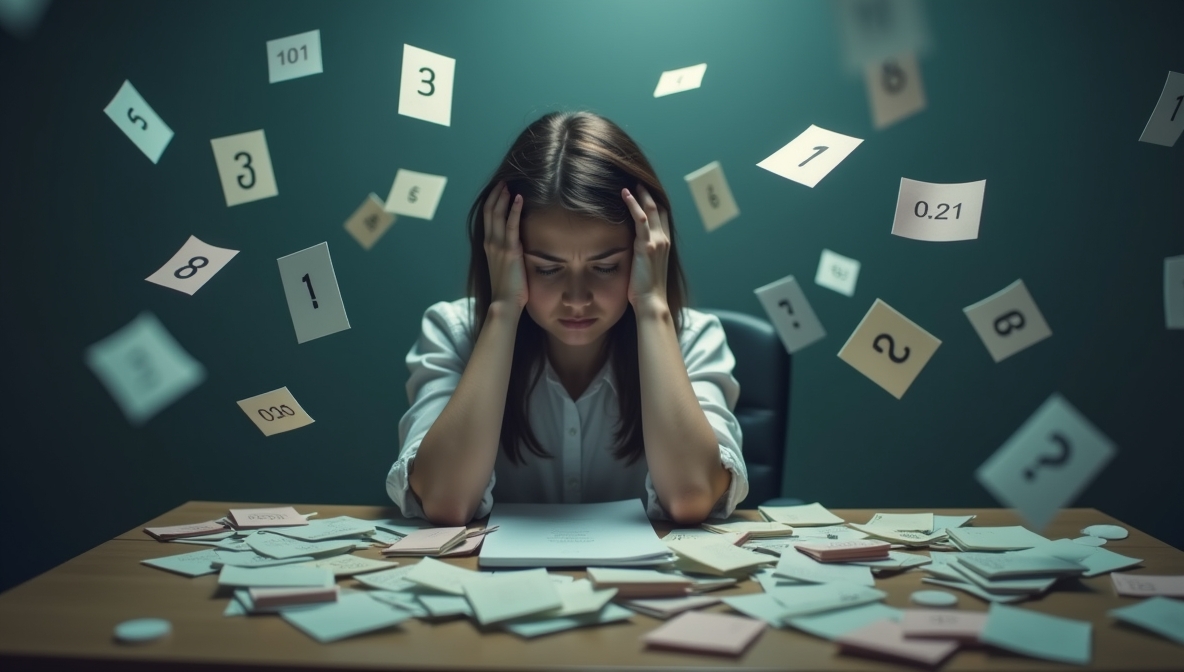
Lorsqu’un mnémoniste cale, on lui conseille souvent de se reposer. Cela semble logique : si le cerveau peine, c’est qu’il est fatigué.
Pourtant, cette vision est trompeuse. Toutes les « fatigues » ressenties lors de l’entraînement n’ont pas les mêmes causes, ni les mêmes remèdes.
Comprendre leurs différences permet non seulement d’éviter des pauses inutiles — parfois contre-productives — mais aussi d’adopter les bonnes stratégies pour retrouver rapidement son niveau optimal.
Fatigue cognitive : un signal d’alerte… mais pas toujours un frein
La fatigue cognitive apparaît lorsqu’on mobilise intensément l’attention, la concentration et la mémoire de travail. C’est celle que l’on ressent après un long entraînement de mémorisation de chiffres ou de cartes. Elle est liée à une baisse temporaire de la disponibilité des ressources attentionnelles et du glucose cérébral.
Pourtant, cette fatigue est souvent plus une sensation subjective qu’une limite réelle. Des études ont montré que les performances peuvent rester stables même lorsque l’on se sent épuisé mentalement.
Chez le mnémoniste, elle signale davantage un besoin de variété qu’un besoin de repos : changer de tâche (passer des chiffres aux mots, ou de l’encodage à la révision) peut suffire à relancer l’engagement.
Ce que disent les recherches
- Pas un “épuisement” du cerveau : signal d’alerte subjectif (Kurzban et al., 2013).
- Ressources encore disponibles malgré la sensation de vide : performances souvent stables (Boksem et al., 2005 ; van der Linden et al., 2003).
- Lien avec le glucose cérébral : baisse modeste et temporaire (Gailliot & Baumeister, 2007).
- Monotonie et lassitude = fatigue ressentie : influence de l’ennui (Llorens et al., 2022).
- Changer d’activité ≠ se reposer : variété = regain d’attention (Llorens et al., 2022).

Fatigue motivationnelle : quand le cerveau fuit l’effort
Parfois, la lassitude ne vient pas d’un effort excessif, mais d’une chute de motivation. Le cerveau évalue en permanence le rapport coût/bénéfice d’une tâche ; lorsque les bénéfices perçus s’effondrent (manque d’enjeu, absence de nouveauté, résultats stagnants), il déclenche un sentiment de fatigue pour inciter à l’abandon.
Dans ce cas, le repos n’aide pas : il faut réactiver l’intérêt. Cela peut passer par un défi chronométré, un changement de format (nouvelle discipline de mémoire), ou un objectif concret et proche. Ces leviers relancent le système dopaminergique et redonnent de l’énergie mentale.
Ce que disent les recherches
- Signal d’alarme plutôt que manque d’énergie (Kurzban et al., 2013).
- La démotivation imite la fatigue mentale (Inzlicht et al., 2014).
- La dopamine pilote la volonté d’agir (Westbrook & Braver, 2016 ; Chong et al., 2016).
- Relancer l’intérêt relance l’énergie (Mekler et al., 2017).
- Des objectifs proches ravivent l’élan (Locke & Latham, 2002).
Fatigue émotionnelle : quand le stress épuise la mémoire
Lors des compétitions, la pression temporelle et l’enjeu social peuvent provoquer une fatigue émotionnelle. Elle ne vient pas d’un effort mental excessif, mais d’un stress chronique : les ressources attentionnelles sont détournées pour gérer l’anxiété plutôt que pour mémoriser.
Dans ce cas, se reposer ne suffit pas. Il faut réguler le niveau d’arousal : respiration lente, activité physique légère, méditation ou cohérence cardiaque. Une fois l’émotion stabilisée, la mémoire retrouve ses capacités — c’est pourquoi les champions intègrent souvent des routines mentales avant chaque épreuve.
Ce que disent les recherches
- Le stress détourne l’attention et réduit la mémoire de travail (Eysenck et al., 2007).
- Le stress chronique épuise les capacités mnésiques (Lupien et al., 2007).
- Se reposer ne suffit pas si le stress persiste.
- Réguler l’arousal restaure les performances (Zeidan et al., 2010 ; Lehrer & Gevirtz, 2014).
- La méditation régulière améliore mémoire et gestion émotionnelle (Hölzel et al., 2011).

Fatigue sensorielle : saturation et perte de rendement
À force d’enchaîner les épreuves sur écran, on rencontre une fatigue sensorielle, liée à la surcharge visuelle et auditive. Les yeux picotent, la concentration décroche, les stimuli deviennent flous.
Ici, de courtes micro-pauses physiques (regarder au loin, marcher, boire) sont très efficaces : elles relancent la vigilance sans casser le rythme comme peuvent le faire de longues pauses.
Ce que disent les recherches
- Les écrans fatiguent les yeux et le cerveau (Sheppard & Wolffsohn, 2018 ; Rosenfield, 2016).
- La surcharge sensorielle réduit la vigilance (Boksem & Tops, 2008 ; Head & Helton, 2016).
- Les longues pauses cassent le rythme (Thomson et al., 2015).
- Des micro-pauses restaurent la performance (Patel et al., 2019).
Bien identifier sa fatigue pour mieux réagir
Confondre ces formes de fatigue conduit à de mauvais choix :
- Se forcer à se reposer quand on est simplement démotivé peut accentuer l’ennui.
- Insister malgré une surcharge émotionnelle peut conduire au blocage.
- Faire une longue pause après une fatigue cognitive normale peut casser la dynamique.
Un mnémoniste efficace apprend à diagnostiquer son état : ai-je encore envie ? ai-je les idées claires ? est-ce l’ennui, le stress, la saturation sensorielle ?
Cette auto-évaluation permet de choisir la bonne réponse : changer de tâche, se détendre, bouger, ou se reposer vraiment.
Ce que disent les recherches
- Toutes les fatigues ne se ressemblent pas (Hockey, 2013 ; Llorens et al., 2022).
- La fatigue est en partie une illusion subjective (Hockey, 2013 ; Boksem & Tops, 2008).
- Une mauvaise réponse aggrave le problème (Inzlicht et al., 2014 ; Boksem & Tops, 2008).
- L’auto-évaluation prolonge la performance (Hockey et al., 1998 ; Ackerman, 2011).
- Adapter sa stratégie est plus efficace que se forcer (Ackerman, 2011).
Conclusion
Toutes les baisses d’énergie ne réclament pas du repos.
Pour un mnémoniste, la clé n’est pas seulement de ménager son cerveau, mais de comprendre ce qui l’épuise vraiment.
Identifier si l’on est cognitivement saturé, démotivé, stressé ou sensoriellement surchargé permet de choisir l’action juste : varier, se recentrer, s’oxygéner… ou se reposer quand c’est réellement nécessaire.
En mémoire comme ailleurs, ce n’est pas la quantité de repos qui compte, mais la qualité des ajustements.